
ATFG - Antony
Amis du Théâtre Firmin Gémier
Actualités théâtrales et culturelles
Printemps 2008
- 12 Mars au 6 avril 2008 : Théâtre des Quartiers d'Ivry, Triptyque Marie Ndiaye.
- Rien d'Humain, mise en scène : Christian Germain
- Les Serpents, mise en scène : Julia Zimina
- Hilda, mise en scène : Élisabeth Chailloux
Création au Théâtre des Quartiers d'Ivry - Studio Casanova
 | Le Théâtre des Quartiers d'Ivry (direction Elisabeth Chailloux et Adel Hakim) a pris l'initiative de demander à trois metteurs en scène de monter trois pièces de Marie Ndiaye. Ces trois pièces - le petit Triptyque de la Dévoration
- peuvent être vues le même jour. Trois styles différents de mise en
scène sur une même écriture. Trois expériences qui nous rappellent que
Marie Ndiaye est une de nos meilleures romancières, qu'elle manipule la
langue avec gourmandise, cruauté et générosité, et qu'elle permet à des
comédiens de donner le meilleur d'eux-mêmes. Photo AFP/Archives - Joël Robine |
Marie Ndiaye est certainement une des romancières les plus respectées
par le milieu littéraire français. Elle n'a probablement jamais été
"best seller", mais son oeuvre a été publiée très tôt par d'excellents
éditeurs (Les Editions de Minuit, surtout). Elle a obtenu une bourse de
la Villa Medicis et le Jury Femina lui a donné son prix en 2001 pour Rosie Carpe. Sa pièce Papa doit manger est au répertoire de la Comédie française depuis 2003. Nous conseillons à nos lecteurs qui veulent découvrir Marie
Ndiaye de commencer
par un roman dont le titre est emblématique de son inspiration, La Sorcière. |  |
Rien d'Humain
Texte : Marie Ndiaye
Mise en scène : Christian Germain
Emmanuel Fumeron
Clara Pirali
(C) Photo Hervé Bellamy


12 mars - 6 avril 2008
Interprètes :
Emmanuel Fumeron, Ignace
Clara Pirali, Bella
Assistante à la mise en scène : Juliette Subira
Scénographie et lumière : Yves Collet
Création sonore et vidéo : Yann Le Hérissé
Chorégraphie : Gilles Nicolas
Costumes : Dominique Rocher
Production des Quartiers d'Ivry avec la SPEDIDAM

« L'Intégrale du Triptyque Marie Ndiaye », débute à 16 heures dans le Studio Casanova, petite salle accueillante. Le Triptyque fonctionne comme un grand spectacle, ses trois volets sont indépendants les décors sont changés en trois quarts d'heures. Ceux-ci sont donc légers. Christian Germain sait nous donner l'impression d'un grand spectacle : cet admirateur de David Lynch (clin d'oeil musical à Twin Peaks) use de décors mobiles, de projection de films qui nous plongent dans un curieux univers, de musique et de lumières qui jouent avec l'ombre et le plein éclairage.
Le Théâtre de Marie Ndiaye n'est pas une écriture faite pour la scène, ses textes sont des pièces radiophoniques, faites pour la voix, sans contraintes de lieux et de décors, mais riches d'une langue imaginative. La présentation sur scène contraint le metteur en scène à imaginer des solutions pour ses jeux avec les lieux et la représentation de ce qui est évoqué dans le texte : l'imagination du metteur en scène crée un monde.
Quel est ce monde ? Le théâtre de Marie Ndiaye évolue entre deux registres, celui de la satire sociale et politique, et celui d'un fantastique fantasmatique. Cette pièce nous initie à son univers cruel et grave, mais aussi drôle et délirant. Deux femmes symbolisent deux mondes : la riche Bella dont la peau et les yeux refléteront toujours qu'elle est née dans la soie et la culture, même quand elle est dans la dêche la plus profonde. Et Djamila, jolie fille issue d'un milieu de prolétaires, accueillie par la riche famille de Bella, éduquée, cultivée et formée. Les deux jeunes filles sont amies d'enfance, et quand Bella a épousé un riche américain, elle a confié son bel appartement et ses beaux meubles à sa meilleure amie. Le mariage américain est un échec, Bella rentre en France et découvre que sa meilleure amie occupe l'appartement avec la ferme intention de ne pas le restituer à sa propriétaire. Bella va se confier à un voisin de Djamila, Ignace, brave garçon, amoureux fou de Djamila qui espère bien être le père de la fille que Djamila cache dans son appartement.
D'un côté, on retrouve la «dialectique du maître et de l'esclave » que l'on doit au philosophe Hegel et que les amateurs de théâtre connaissent par la pièce de Brecht : Maître Puntila et son valet Matti. La thématique a été renouvelée par Bernard-Marie Koltès, qui au couple maître-esclave issu de la lutte des classes, substitue le couple dealer-client. Dans la solitude des Champs de Coton, il pose à nouveau la question : dans un rapport inégalitaire, qui est vraiment le maître, qui est vraiment l'esclave ?
Djamila née pauvre ne peut pas aimer Bella née riche. C'est onthologique. Est-on dans un pur déterminisme social ? On pourrait le croire, et voir alors un mélodrame social, bien ancré dans une tradition théâtrale très représentée aujourd'hui. Mais Marie Ndiaye joue sur toutes les ambiguités : ses héros (et surtout ses héroïnes) avant d'être déterminé(e)s par l'appartenance à une classe, sont d'abord des monstres d'égoïsme, et il faut prendre le mot monstre dans tous ses sens, y compris ceux du conte traditionnel. Il faut ici se limiter à «Rien d'Humain » car nous retrouverons tous ces thèmes dans les deux autres volets du Triptyque.
À côté de la symbolisation de la classe possédante sûre de son bon droit - représentée par Bella - et de la classe des exploités révoltés - représentée par Djamila - il y a une subtile dérive vers d'autres rivages, qu'il ne faut pas trop dévoiler pour respecter le plaisir de la découverte : Djamila ne serait-elle pas une sorcière et l'appartement de Bella n'est-il pas devenu une antre ? Bella est-elle une brave fille issue d'un milieu riche et bien pensant, ou bien a-t-elle - elle aussi - connu des drames, et des forces obscures s'expriment-elles également par sa bouche ? Est-on dans la lutte de classes, ou dans une lutte pour le pouvoir au sein d'un couple infernal sacrificiel qui a besoin d'une victime expiatoire pour créer l'équilibre peu stable où il peut vivre ? Ou, mieux, la situation de classe permet-elle à des psychopathes d'exprimer leur sado-masochisme intime ? Ce vocabulaire (politique, psychiatrique) est-il adapté à une situation qui mêle de façon trop imbriquée le social et le psychique ? C'est là que l'art montre sa capacité à dire des situations trop complexes pour être analysées par les moyens classiques.
Le "casting" est impeccable et s'intègre avec une justesse totale
dans le projet esthétique de la mise en scène. Sandra Faure (Djamila) a la seduction perverse et la violence volontariste du personnage. Clara Pirali
(Bella) use d'une extrême blondeur pour afficher son appartenance de
classe et son innocence, et pouvoir en fin de parcours montrer à son
tour la perversion nécessaire. Emmanuel Fumeron
(Ignace) est parfait dans un rôle de victime qui exige tout à la fois
de la bonne volonté et de l'énergie mal récompensée. Il faut voir cette pièce, pour un texte riche et une mise en scène qui nous fait quitter petit à petit les lieux balisés du psychologique et du social, pour la dégringolade sur le toboggan infernal de la cruauté profonde, et fascinante, des êtres. Christian Germain montre sa capacité à faire sentir et voir le fantastique dans le quotidien imaginé par Marie Ndiaye. |  |
23 mars 2008
Christian Germain est un des metteurs en scène qui font vivre la scène artistique et culturelle de la Banlieue Sud. Au Théâtre Firmin Gémier d'Antony, nous avons pu voir quelques unes de ses mises en scène :
Christian Germain a écrit des notes éparses sur Rien d'Humain.
|
Les Serpents
Texte : Marie Ndiaye
Mise en scène : Julia Zimina
Hélène Lausseur
Céline Chéenne
Eléonore Briganti
Photo Hervé Bellamy


Éléonore Briganti, Nancy
Hélène Lausseur , Madame Diss
Scénographie et lumière Yves Collet
Costumes Dominique Rocher
Maquillage Nathalie Casaert
Nous avions récemment vu une mise en scène, très réussie, de Julia (ou Youlia) Zimina au TOP de Boulogne-Billancourt. Il s'agissait du Kaddish de Grigori Gorine où jouait François Kergourlay, qui fut directeur du Théâtre Firmin Gémier d'Antony. Les Serpents : dans la mise en scène de Julia Zimina, la hiérarchie des rôles n'est guêre symbolisée par la hiérarchie sociale. C'est plutôt une hiérarchie familiale qui est mise en jeu : la « mère », Madame Diss, le «fils» (quel est son nom ?), la « première belle-fille», Nancy, puis la « seconde belle-fille», France, sans compter les «petits-fils», qui s'appellent tous «Jackie». Il y à ceux (en fait : celles) qui sont sur scène, et ceux dont on parle beaucoup et qu'on ne voit guère. On peut les entendre : on ne peut pas dire que le son de leur voix témoigne de la qualité de la communication au sein de cet étrange cellule familiale.
Le décor est très simple : une rangée de lampes divise le plateau en deux : derrière elle l'espace d'entrée de la maison symbolisée par une grande porte que l'on ne franchit pas aisément, et devant elle l'espace d'arrivée par la route où se tiennent ceux (ou plutôt, celles) qui ne pénètrent pas dans la maison. Il y a des paroles aux statuts différents. Il y a les paroles échangées entre celles qui sont «dehors». Et il y a les paroles qui franchissent la rangée de lampes et qui relient ceux (ou celles) qui sont «dehors» et ceux (ou celles) qui sont «dedans». Ces lampes alignées peuvent symboliser le champ de maîs, seule production de cette ferme bizarre , mais aussi le feu d'artifice qu'on promet pour le soir : le 14 juillet seule fête promise aux enfants (quels enfants ?) qui vivent (peut-être) dans la maison. Seule fête ? alors, c'est important.
Deux femmes sont venues en ce brûlant 14 juillet : la mère et la première belle-fille. Toutes deux attendent quelque chose du fils qui dort (qui dort ?) dans cette maison fermée. La mère est dans la dêche, et elle attend de l'argent de la part de son fils. Madame Diss a eu des vies antérieures brillantes, de nombreux maris qui l'aiment toujours. Mais là, elle a besoin d'argent et elle est prête à tout pour en obtenir. Par exemple, elle peut vendre ses souvenirs . Cette «dealer» a justement une «cliente» , son ex-belle-fille, Nancy qui veut savoir comment son fils «Jackie» est mort. Où est-il enterré ? Nancy veut que le «père» l'accompagne au cimetière. Elle est donc prête à payer jusqu'à son dernier sou, et à se sacrifier (se sacrifier ?) pour savoir. Si elle est partie, abandonnant mari et fils, c'est qu'elle avait peur - peur de quoi ? Elle a été remplacée par la seconde belle-fille, France, petite femme insignifiante que le fils a «ramassée»: a-t-elle donc gravi les échelons de la société en épousant ce fils ?
Ces femmes ont peur du fils dont on entend quelque fois la «voix», mais ce fils, on ne le dérange pas. On ne le réveille pas quand il dort. On le sollicite, avec crainte et tremblement. Et pourtant ces femmes sont patientes, elles s'incrustent, elles veulent le voir, elles veulent obtenir son argent (en a-t-il vraiment ?), elles sont prêtes à retourner vivre avec lui. Quelle est cette destinée qui les ramène toutes vers l'antre de cet ogre ? Quelle est cette société où les Ogres mangent réellement les Petits Poucets ? Où les femmes de Barbe-Bleue vont d'elles-mêmes vers les chambres mortuaires ?
| La mise en scène par Julia Zimina de cette fable noire et cruelle montre bien les rapports de force qui s'exercent au sein d'une famille très modeste. Un monde quotidien décalé glisse peu à peu vers un monde fantastique de plus en plus terrifiant. Mais on n'est pas dans la représentation de l'horrible, non. On entend des dialogues qu'on peut qualifier de «brillants», mais on est loin des «mots d'auteurs» : Marie Ndiaye a un grand don pour jouer avec la langue, ce qui lui permet de distiller avec virtuosité sa cruelle petite histoire. Hélène Lausseur a la classe pour jouer le rôle de Madame Driss, mais elle n'en a peut-être pas encore l'âge. Céline Cheenne réussit à être rayonnante dans le rôle de la pauvre fille ramassée dans le ruisseau et devenue la porte-parole de son ogre de mari. Éléonore Briganti a le rôle délicat de celle qui vient réclamer des comptes, et qui accepte de redevenir une victime. Dans ce théâtre de la cruauté moderne, il y a toujours des victimes sacrificielles qui semblent avoir cherché ce destin. |  |
Hilda
Texte : Marie Ndiaye
Mise en scène : Élisabeth Chailloux

Clémence Barbier, Corinne
Elisabeth Chailloux , Madame Lemarchand
Etienne Coquereau : Franck
Assistantes à la mise en scène : Clémence Barbier et Louise Loubrieu
Vidéo : Michaël Dusautoy
Son : Anita Praz
Scénographie et lumière : Yves Collet
Costumes : Dominique Rocher
 Elisabeth Chailloux (C) Photo Hervé Bellamy | La troisième pièce du Triptyque Marie Ndiaye affiche la composante sociale et politique des « petits Traités de la Dévoration (extra)ordinaire » : c'est une authentique bourgeoise qui a la parole (et qui ne la lâche pas). Mais une bourgeoise particulière qui adore exhiber son âme et sa compassion. De son passé de « révolutionnaire » elle a gardé le goût de la militance et, avec son mari, elle est entrée au « Parti radical ». Elle a décidé de faire le bonheur de celles qui sont à son service. Mais voilà, cette grande bourgeoise qui affiche son progressisme, ne supporte pas d'élever ses enfants elle-même, ne serait-ce qu'une seule journée. Elle a un besoin urgent d'une nouvelle femme à son service. Et sans la connaître, elle s'est entichée d'Hilda : quel beau nom qu'Hilda ! |
Hilda a la réputation d'être belle, propre, courageuse au travail. Madame Lemarchand veut Hilda, qui a deux enfants. La patronne sait déjà tout et elle a tout prévu. Elle sait ce que gagne le mari d'Hilda, Franck - qui travaille à la scierie. Elle a déjà retenu des places à la crêche pour les enfants du couple. Franck ne peut pas refuser de demander (imposer ?) à sa femme de travailler chez les Lemarchand. Il est maintenant question du mari. La pièce est d'abord un monologue - un brillant monologue - de Madame Lemarchand devant ce mari, laconique, qui essaie de résister, mais qui finit toujours par céder. La bourgeoisie tient le discours, les prolétaires parlent peu et ne savent pas se défendre, surtout devant l'argent. Un argent qui a l'air abondant, mais qui ne l'est guère quand on fait les comptes. Cependant comment résister aux discours de Madame Lemarchand qui a réponse à tout et qui veut le bien de son personnel ?
Là, on peut faire une double lecture. La plus convenue est sociale : une bourgeoise riche s'approprie une prolétaire pauvre, et la force du langage va de pair avec la force de frappe monétaire. La pièce suit d'ailleurs plus ou moins cette voie : quand Madame Lemarchand cherche à s'approprier complètement Hilda en la faisant travailler chez elle le jour, le soir, et (pourquoi pas ?) la nuit, Franck a un accident du travail, il arrête de travailler, et comme il travaillait au noir il n'a plus aucune ressource : la pièce commence à suivre la voie glissante du « mélodrame engagé ». Mais Marie Ndiaye a bien des talents. Elle ne renonce pas à la leçon de choses sociale et politique, et la pièce commence aussi sa dérive vers la cruauté (extra)ordinaire.
Madame Lemarchand parle beaucoup, c'est même le sujet de la pièce : voir une patronne qui ne cesse de parler. Donc elle parle trop, et elle finit par faire des aveux qu'elle ne devrait pas faire : on sait qu'elle ne supporte pas d'élever ses enfants elle-même, elle n'intéresse plus son mari. En recrutant Hilda, Madame Lemarchand cherche d'abord à acheter de l'amour. Madame Lemarchand veut qu'Hilda l'aime. Elle cherchera même à séduire Franck. Mais elle échoue toujours dans ses achats d'amour. Alors elle détruit, et on voit que ses «bonnes intentions» pavent les chemins de l'enfer : Hilda ne l'aime pas et ne l'aimera jamais, mais elle est sa prisonnière, dont on ne saura jamais si elle est consentante, si elle obéit aux ordres de son mari, ou si c'est son caractère. Car s'il est beaucoup question d'Hilda, du beau nom d'Hilda, Hilda n'est qu'un nom et on ne verra d'elle qu'une image à deux dimensions, son joli fantôme.
Interrogeons-nous sur la « structure en abîme » de cette représentation. La pièce est un brillant exercice de pouvoir par la parole, plus que par l'argent. Cette parole est d'abord celle que nous transmet l'écriture de son auteur : Marie Ndiaye est une magicienne de la langue. Cette parole est dite par une comédienne toujours en scène : Élisabeth Chailloux, qui bénéficie du « physique classe » qu'on attend d'une grande bourgeoise autoritaire qui feint (feint ? comment savoir ? elle est sûrement sincère) d'aimer son petit personnel. Élisabeth Chailloux distille son texte avec élégance et gourmandise. Élisabeth Chailloux est aussi la directrice du TQI, c'est donc elle qui a décidé de la création de ce Triptyque Marie Ndiaye sur les rapports de pouvoir et de la dévoration au quotidien. Le «pouvoir» est ici représenté à tellement de niveaux qu'on s'y perd. Il faut voir l'œil d'Élisabeth Chailloux briller quand elle va se lancer dans un de ces discours qui va écraser le prolétaire laconique qui voudrait bien lui faire face. Il doit y avoir une jouissance à jouer un rôle de «vampire psychique psychopathe», et il y a pour les spectateurs un immense plaisir à voir cet exercice.
Il n'y a guère de « morale» dans cette pièce : la puissante bourgeoise est à son tour prisonnière de sa victime qui a poussé à son extrême absolu l'art de la défense passive, en se détruisant elle-même, mais en détruisant aussi son bourreau.
Face à une impériale Élisabeth Chailloux, Étienne Coquereau a une étonnante présence physique (nécessaire, car il ne parle guère). Son personnage cherche à montrer un minimum de « résilience » face à ces déterminismes qui l'écrasent. Il arrivera enfin à résister, à l'aide de sa jeune belle-sœur Corinne (Clémence Barbier), celle qui n'accepte ni d'obéir, ni de voir Franck tenter d'assassiner Madame Lemarchand. Il y a donc bien des personnages qui résistent, mais dans toute ces pièces de Marie Ndiaye, il faut qu'il y ait une «victime émissaire». Ici, c'est « l'Arlésienne », celle dont on ne voit que le fantôme, mais dont le nom est constamment magnifié par le verbe de l'auteur et la voix des comédiens, et avec lequel il faut achever cette chronique: «Hilda ». | 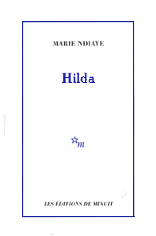 |
24 mars 2008